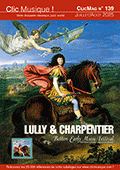Transportés au temps de Brahms, qui a régulièrement joué avec les plus éminents solistes, à commencer par l’ami Joachim, apprécierions-nous leur dialogue ? Nous serait-il intelligible ? « Nous n’y comprendrions rien, j’en ai peur » : réponse de Nikolaus Harnoncourt, pourtant chantre des instruments anciens dans Bach et Monteverdi. De fait, quelques rouleaux enregistrés au soir de sa vie par Joachim nous font basculer dans un autre monde et nous rappellent qu’au renouveau des compositions répond la métamorphose, plus souterraine, des styles de jeu instrumentaux. La moisson discographique des années 1930 à 1950 est à cet égard précieuse. Brahms et ses partenaires ne sont plus mais un Busch, un Szigeti et bien d’autres ont recueilli leur enseignement ou leurs conseils. Ne soyons pas naïfs. La tentation est grande d’entendre une « tradition » dans le cycle brahmsien de Busch pour HMV, et pourtant personne avant lui ne jouait Brahms comme lui – si certains choix de tempos ou de rubatos coïncident avec les recommandations de Jeno Hubay, son jeu n’était pas moins marqué par sa rencontre avec Schönberg, une nouvelle approche de l’analyse musicale, un nouveau type de « précision » développé devant les micros. La densité du phrasé de Busch repose autant sur son héritage que sur son émancipation : une tension également fertile sur les claviers d’Edwin Fischer, Rubinstein, Horszowski, l’alto de Primrose, ou la clarinette de Reginald Kell… Visitons ce coffret comme un bosquet à la croisée des chemins, entre un monde perdu mais pas si lointain, et l’affirmation d’une modernité, pas ¬seulement technique, incarnée notamment par le Quatuor de Budapest. Sept collègues m’ont prêté main-forte pour cette sélection, qu’ils soient tous remerciés d’avoir respecté la consigne qui guide volume après volume notre Discothèque idéale : tout réécouter. Un tel projet risque toujours de voir la sélection dominée par un interprète ou une famille musicale – nous en sommes loin. La moitié des gravures réunies avait déserté le catalogue. Les collectionneurs priseront tout particulièrement les deux Sonates pour clarinette par Kell et Horszowski, dont c’est la première édition en CD. La Sonate op. 108, le Quatuor op. 25 et le Trio avec cor, présentés deux fois, ont soulagé des cas de conscience. Quel contraste, d’ailleurs, entre les versions du Trio avec cor gravées avec Serkin, en 1933 et 1960 ! Autre « bonus », les quatre lieder cités dans les sonates pour violon, qu’aucun disque encore ne leur associait.
 |