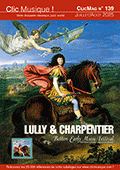Peter Skalka prélude à la Première Suite en improvisant, histoire de faire se marier l’archet et les cordes en boyau, de chauffer le son de l’une des quatre grandes caisses qu’il alternera au cour de cet enregistrement réalisé dans son fief de Valy. Ce violoncelliste si prisé des ensembles baroques, tenant de l’interprétation historiquement informée, est d’abord un poète de son instrument qui écoute les mystères sonores que Bach aura inscrit dans les Six Suites. Des suites de danses d’abord diraient ses collègues baroqueux. Pas à ses yeux, pas seulement du moins, son art réflexif médite plus qu’il danse (et lorsqu’il danse c’est en dégageant un troublant sentiment d’intimité), il ne serait pas loin d’atteindre une certaine ascèse , comme a rebours de tout ce que les violoncellistes de sa génération auront tenté, pas si loin en fait du tête à tête solitaire de Casals et de son violoncelle, et jusque dans une certaine raucité, dans l’indifférence au beau son. Cela en surprendra plus d’un, qui l’aurait attendu extraverti, mais non, ses Suites, comme sa transcendante transcription de la Chaconne de L’ Ange Gardien volée au Rosaire de Biber sont, élevées par son archet, six exercices spirituels visant à un dénuement quasi abstrait. Ecoutez seulement. (Discophilia - Artalinna.com) (Jean-Charles Hoffelé)  D’origine tchèque le violoncelliste Petr Skalka a été formé à la Schola Cantorum Basiliensis auprès de Christophe Coin. Il se produit régulièrement dans de nombreux ensembles baroques (Café Zimmerman, ensemble baroque de Limoges...) et a participé à quelques enregistrements notoirement éloquents (l’op. 5 de Richter avec Il Rincontro et un disque consacré à Johannes Matheson (Der Brauchbare Virtuoso). Ce double disque le montre seul avec son violoncelle et confronté à l’inatteignable Everest des violoncellistes, quintessence de l’art musical (Casals) : les Suites de Bach qu’il présente d’ailleurs avec une pincée d’humour dans son introduction résumant le fonction de la basse dans la musique depuis la première école de violoncelle publiée en 1741 préfacée ainsi par Michel Corrette : « Noble soutien de l’harmonie – Qu’avec majesté tu nous seras – par ta divine mélodie – tu donnes l’âme à nos concerts ». Suivant fidèlement ces préceptes, Skalka maintient une prudente ligne de conduite tout au long des cinq Suites, une façon d’horizontaliser le discours, la mélodie. Les tempi sont raisonnables, propices à une articulation parfaite. Les phrasés sont pesés (Préludes, Allemandes), les danses (Bourrées, Gigues, Gavottes) jouées avec une belle ferveur. Rien qui jure, qui titille ou qui étonne (en regard de la masse de versions existantes) mais une tenue et une endurance remarquables qui force le respect et l’écoute. Skalka nous a mitonné une petite improvisation en guise de mise en bouche (initio) et termine son récital par une décapante transcription de la Passacaille en do mineur tirée des Sonates du Rosaire de Biber. Chapeau ! (Jérôme Angouillant)  With these words begins the first written cello method, authored by Michel Corrette and published in Paris around 1741: the cello, a bass instrument, is considered a “noble pillar of harmony”. At that time, music history was roughly in the middle of the basso continuo era, which began during Monteverdi’s lifetime with the “Seconda Pratica” and ended during Robert Schumann’s lifespan. A lot revolved around the melody of the bass line, its realisation and rendering. In Corelli’s orchestra, a large bass section comprising many instruments of different sizes, with several cellos, double basses, lutes and harpsichords, was placed just behind the concertino. Behind them were the intermediate voices, first and second violas. Only behind the latter were those who carried the melody of the upper voices, namely the violinists. Such a setting has nothing to do with today’s musical practice and sound expectations. The vast bass section determined the tempo, the character and the dynamics. Those providing the melody had to adapt; any resistance would have been pointless. With this in mind, the title page of J. S. Bach’s Cello Suites may seem revolutionary at first glance: “6 Suites a Violoncello solo senza basso”. A musical work dedicated to an important instrument, the pillar of harmony, but “senza basso”, without bass! And this in an age in which there could be no music without bass, given the compositional method and practice of the basso continuo! In reality, the bass is clearly present in these solo suites. The designation “senza basso” is intended to warn the performer that there is no point in leafing through the pages of the score in search of the bass line. The bass is, in fact, already present in the monophonic solo part.
 |