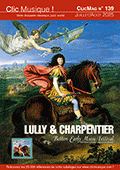C'est par ces mots, retraduits en français , que se présente, en allemand et en anglais cette compilation de concertos de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, conçus pour trompette et orchestre par des compositeurs pour la plupart au service de cours d'Europe centrale qui, à l'exception de J.M. Haydn sont tombés peu à peu dans l'oubli (ainsi de Joseph Riepel, de J.W. Hertel, ou encore de F.X. Richter qui passa ses 20 dernières années à Strasbourg), tandis que F. Querfurth resta presque inconnu. À l'orchestre se substitue ici un orgue : celui qui, à Dresde, remplace le Silberman détruit en 1945 par le feu, et combine (avantageusement, selon la notice!) la tradition du baroque allemand et celle de l'orgue romantique. On sait qu'à l'ère «baroque» la pratique de la transcription était fréquente (Bach n'était pas en reste à cet égard), mais les motivations qui président ici à l'entreprise d' «arrangement » des interprètes, semblent dérisoires. En France, certes, vers 1960, une organiste aussi accomplie que M.C. Alain se livrait avec Maurice André, immense virtuose de la trompette , à des adaptations stylistiquement peu défendables de chorals de Bach ou de concertos baroque italiens , mais on était justement dans les années 60 : ces musiciens étaient mus par un pur souci de vulgarisation, et l'orgue n'attirait pas les foules. Ce genre d'attelage allait disparaître avec la redécouverte du baroque, l'essor progressif de ce qu'on nomme désormais " interprétations historiquement informées" et les évolutions que connut le jeu de chacun des membres de ce fameux tandem. Ici, « c'est autour d'un verre de vin que l'idée de tels concerts a germé » chez les deux interprètes. De là l'organisation d' «Orgelfahrten » – «tournées» annuelles se déroulant à chaque fois, «pendant plusieurs jours, dans une région différente d'Allemagne». Il s'agit de «faire sonner le plus d'orgues possible en un minimum de temps». Le défi, c'est la confrontation à des «conditions de travail » toujours différentes, car chaque orgue est un «individu à part entière, [...] ». L'organiste se forge ainsi un « savoir-faire artisanal grâce auquel il peut produire les images sonores les plus intéressantes et les plus variées et tenir compte de manière optimale du soliste, permettant à ce dernier de surpasser les couleurs d'un orchestre qui risquerait, quant à lui, de l'écraser» . Il faut aussi « déployer tout un art pour générer une atmosphère d'intimité sonore ». La joyeuse compétition (!) entre amis rappellerait l'ambiance de celle d'une« jam session de jazz» : ces œuvres vieilles d'environ 250 ans semblent naître au moment même où on les entend : un vrai rafraîchissement que ces concerts ! Or, l'écoute ne confirme guère ces impressions. Car si la trompette tire vaillamment son épingle du jeu et s'affirme avec énergie et prestance, sans jamais manquer d'éclat, l'orgue flonflonne, semble patiner mollement dans les méandres d'un rococo stéréotypé, répétitif, feutré et ennuyeux, pour tout dire. (Bertrand Abraham)  Trumpet concertos accompanied by an organ instead of an orchestra – this idea came to Helmut Fuchs, principal trumpet of the Sächsische Staatskapelle Dresden, and the Dresden Frauenkirche cantor Matthias Grünert some time ago. For their project, the two artists chose works from the 18th century, written by composers who are rather unknown today – unjustly, one might think, when listening to this recording. It is characterised by great virtuosity as well as a refreshing liveliness and joy of playing, reminiscent of the character of a jam session. A successful new arrangement of rarely performed works.
|