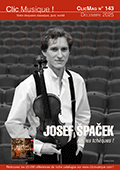Coffret triplement intéressant, d'abord pour sa présentation remarquable (les gravures sur bois expressionnistes qui ornaient les pochettes originales) ensuite pour son contenu, l'hommage au chef Herbert Kegel qui n'eut de cesse à Leipzig où il fut chef permanent puis à Dresde, de créer des œuvres de compositeurs d'Allemagne de l'Est (Eisler, Dessau, Wagner-Régeny) ; enfin pour son programme : les deux opéras de Carl Orff, Die Kluge, Der Mond et le « Trittico teatrale » : Trionfi ; l'ensemble enregistré dans les années 70-80 (Ici dans une prise de son remastérisée superlative) avec les forces de Leipzig. L'écriture des deux opéras (1939 et 1943) diffère peu de celle de l’œuvre princeps de Orff : Carmina Burana (1937), rythmique à base d'ostinatos, de formules répétées, une scansion chorale, des récitatifs déclamés et de quelques airs qui tempèrent la tension ambiante et motrice. Orff tout en s'inspirant du folklore populaire (Des contes de Grimm), mélange spectacle de cabaret et imaginaire médiéval pour aboutir à des œuvres qui tiennent à la fois du pastiche, du singspiel et du divertissement, « ...non dépourvu de fond philosophique » (Piotr Kaminski). Le triptyque Trionfi fut composé entre 1939 et 1953, trois œuvres qui possèdent une thématique voisine, l'apport de textes anciens. Un manuscrit médiéval du XIIIe siècle (Carmina Burana), des vers du poète Catulle (Catulli Carmina) complétés par ceux de Sapho et d'Euripide (Trionfo di Afrodite). Elles témoignent de la fascination du compositeur pour la poésie lyrique : « Ces lignes courtes comme taillées dans la pierre me fascinèrent, elles brillaient de tout leur éclat, pour moi elles incarnaient la musique ». Rythmique imparable, ductilité de l'orchestre, réactivité et articulation des chœurs et de chaque soliste et récitant. Kegel fait de ce triptyque une lecture objective, nerveuse et acérée, accusant la dramaturgie bien loin de toute esbroufe, et respectant rigoureusement la partition et l'aspect central de l’œuvre : l'intégration (Jugée inintelligible pour certains critiques de l'époque) de la langue (Latin ou allemand) dans le corps d'une musique originale et accessible qui puise à des sources multiples : du grégorien au jazz en passant par Bach et Monteverdi. (Jérôme Angouillant)  Herbert Kegel’s series of Carl Orff recordings seems out of place (from today’s conventional box-ticking perspective) for a conductor known for his passionate commitment to the modernist works of the Second Viennese School. Herbert Kegel’s aesthetic horizon crossed borders of every kind and made no compromises in its expansiveness. The same painstaking refinement that he applies to Webern’s filigree textures is prominent in his treatment of “Carmina Burana”, often presented as a larger-than-life audience-friendly “showpiece”, but here endowed with a rarely experienced aura of ritual solemnity and seriousness.
|