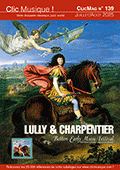Un disque réussi ! Le romantisme dans le rétroviseur d’un phare du modernisme. Moins célébré que la prodigieuse triade chorégraphique de la période russe ("Oiseau de feu", "Pétrouchka", "Sacre du printemps"), Le "Baiser de la Fée" est un hommage à Tchaikovski dont il recycle diverses mélodies pianistiques et vocales. Commandé par la danseuse Ida Rubinstein en 1927, inspiré par un conte d’Andersen, ce ballet évoque l’union fatale d’un jeune Suisse et de la Fée des neiges, qui le ravit finalement à sa fiancée pour l’emmener dans son empire éternel. Stravinski en condensa un Divertimento qui fut enregistré par quelques grandes baguettes (Ferenc Fricsay, Igor Markevitch, Fritz Reiner, Riccardo Chailly, Semyon Bychkov…). À l’instar d’Ernest Ansermet (mai 1951 puis mai 1962), Vladimir Jurowski est de ces rares chefs à avoir abordé à la fois cette Suite (Pentatone, octobre 2004) et l’intégralité des quatre scènes originales. Avec ses musiciens de Leningrad, Evgueni Mravinski (réédité en SACD chez Praga) traçait une fable en noir et blanc d’essence tragique. Au milieu des années 1990, Riccardo Muti (Sony), David Atherton (Virgin) et Oliver Knussen (DG) ciselèrent les textures néoclassiques avec raffinement, orbitant parfois dans le sillage décanté de l’ "Apollon Musagète" contemporain. Tout comme Ansermet, Jurowski déporte cette subtilité vers un humour volontiers truculent, aux accents presque vaudois dans la fête villageoise qui profite des grasses couleurs du London Philharmonic. Dans l’Allegro sostenuto, le Vivace agitato, le maestro russe sait être anguleux comme l’ancienne gravure de Guennadi Rojdestvenski (Melodiya). Il n’élonge pas l’épilogue, et aura concentré une lecture tendue et savoureuse, sensuelle et charpentée, sans toutefois retrouver l’intense caractérisation du compositeur lui-même à Cleveland (Columbia, décembre 1955). À l’exemple de Neeme Järvi (Chandos), le programme est abondé par le Pas-de-deux de "Barbe-bleue", tiré de la "Belle au Bois dormant" et arrangé par Stravinski, qui en orchestra aussi deux extraits retranchés par Tchaikovski. Ces trois compléments sont ici encore magnifiés par l’interprétation généreuse et sanguine de la phalange anglaise, plantureusement captée. (Christophe Steyne)  On le sait, la révolution Berlioz fut initiée en Albion, Hamilton Harty tira le premier en 78 tours dès les années trente, Colin Davis sacrant tout l’œuvre dans la glorieuse stéréophonie de Philips, John Eliot Gardiner y ajoutant ses interprétations historiquement informées. La "Damnation" échappa un peu tout de même aux anglais, du moins au disque, Igor Markevitch et Charles Munch lui donnant cette folie nervalienne que Davis n’y osait pas et dont la rationalité de Gardiner n’avait cure. Edward Gardner ne suivra pas ses compatriotes, il ose comme les Français mêler la musique de la nature et le fantasque du délire, et demande à ses chanteurs de vraies incarnations. Bravo à John Irvin, Faust éperdu et vertigineux qui soigne son chant et son français, bravo au "Méphistophélès" de Christopher Purves, mordant et charmeur, même si l’on peut regretter que le chant stylé de Jonathan Lemalu n’ait à s’occuper que de Brander, bravo à Karen Cargill, Marguerite éperdue dont le grand mezzo sombre saisit dans ses étoffes somptueuses toute la psyché complexe, et comme elle va jusqu’à l’hypoxie pour l’emballement "D’amour l’ardente flamme". Qui l’osait à ce point, sinon Jessye Norman ? Edward Gardner dirige sans conteste un opéra, unissant les scènes dans un récit dramatique qui leur fait trop souvent défaut au disque, précipitant le drame vers la coda du pandémonium où les chœurs se couvrent de gloire, quelle proposition ! Qui laisse espérer la suite de ce qui pourrait constituer un nouveau cycle Berlioz face à celui de John Nelson parvenu à ses derniers feux. (Discophilia - Artalinna.com) (Jean-Charles Hoffelé)
 |