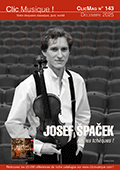À l’école de Wilhelm Kempf, Claudio Arrau, et distingué par Geza Anda, Gehrard Oppitz (1951), à l’instar du chef d’orchestre Daniel Harding et de son collègue pianiste italien Roberto Cominati, est également pilote d’avion. On ne saurait dire, toutefois, par le sérieux et le profond investissement de ses lectures qu’il propose des survols des cycles pianistiques auxquels il se confronte : en attestent Bach, Grieg, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms et aujourd’hui Schumann, avec ce second volume d’un nouveau massif en devenir. La composition de cet enregistrement retiendra tout d’abord l’attention, qui dénote le souci de faire dialoguer des œuvres de la seconde moitié de la grande période créatrice de Schumann pour le piano (1830-1840) avec deux œuvres qui marquent le début et le terme de son activité de compositeur. Ainsi "Papillons", op. 2 de 1831 converse avec les trois "Fantasiestücke", op. 111 de 1851, tandis que le "Carnaval", op. 9 de 1837, la Sonate en Fa dièse mineur op. 11 de 1836, les "Kinderszenen", op. 15 de 1839 et les trois "Romanzen", op. 28 de 1840 s’inscrivent dans cet orbe tragique d’une vie marquée par l’hypocondrie, la dépression et l’incapacité de devenir "un des plus grands pianistes vivants, plus spirituel et chaleureux que Hummel, plus grandiose que Moscheles" que lui prédisait Friedrich Wieck. Un enregistrement qui est une sorte d’analyse spectrale de la créativité de Schumann pour le piano, ce qu’accentue particulièrement le jeu réfléchi et concentré de Gehrardt Oppitz, son "piano épais" comme l’écrivait en 2014 Jean-Charles Hoffele, est particulièrement bien adapté à l’image que l’on se fait de Brahms, mais certainement moins adéquat aux sauts d’humeur imprévus si caractéristique de Schumann. Une lecture de Schumann qui propose une intrigante vision très pensée de ses compositions, fort bien servie par une prise de son opulente. (Jacques-Philippe Saint-Gerand)
 |