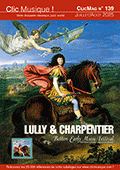450 ans ! Ce n’est pas un petit anniversaire pour la Staatskapelle de Berlin, qui fut au 78 tours un orchestre sollicité par rien moins que Richard Strauss, Max von Schillings ou le jeune Karajan. Deutsche Grammophon sort un fort coffret couvrant toute l’histoire phonographique de l’autre orchestre berlinois qui sut s’imposer face au Philharmoniker, Berlin Classic se concentre sur l’ère d’Otmar Suitner qui fit les belles heures du label Eterna au temps de la stéréophonie. Les prises de son idéalement équilibrées réalisées dans l’Evangelische Chrsituskirche magnifiaient une phalange qu’Otmar Suitner avait sculptée à son image : son clair, polyphonies en lumière, registres nettement différenciés, tout cela au service d’un art qu’on a par facilité qualifié d’objectif. Otmar Suitner n’était absolument pas un allemand de l’Est, mais un pur autrichien, formé par Clemens Kraus, la Staatskapelle de Dresde avait reconnu en lui un héritier de l’art de Richard Strauss, il la dirigea quatre années durant et leurs noces se seraient prolongées si on ne lui avait offert en 1964 la direction musicale du Staatsoper de Berlin et, concomitamment, les destinées de la Staatskapelle. La roideur de sa Deuxième Symphonie de Mahler m’a toujours surpris, c’est Klemperer sans les effets, mais avec le même sens du crescendo imparable inscrit dans le temps long qui nous aura valu un des plus impressionant Maestoso au disque. Pourtant, c’est dans le grand arc de la Septième de Bruckner que ce ménestrel autrichien révèle tout son art, voyez seulement le vaisseau de Tristan qui traverse tout l’Adagio. Et comme cela chante, Suitner fut un remarquable chef de fosse, ses Ouvertures de Mozart su stylées et si vivantes – le microsillon fut un best seller en RDA – le prouvent, comme tout le théâtre qu’il fait resurgir dans la fantaisie symphonique de la Frau ohne Schatten. Des raretés s’ajoutent, du Dessau dont il fut l’apôtre, créant ses opéras, une farouche Penthesilea de Wolf, des extraits de la Kätchen de Pfitzner qui vous donneront envie d’aller chercher son Palestrina, ses Wagner de Bayreuth. Puis, au milieu de cette anthologie où manque un peu la veine tchèque qu’il savait si bien magnifier (cherchez ses Symphonies de Dvorak !), soudain un elfe parait, le jeune Günther Herbig, venu d’un autre monde, qui nous fait le plus mozartien des Songes d’une nuit d’été, gravure impérissable où l’orchestre s’allège, les rythmes folâtres, les mélodies s’envolent, écoutez seulement. Belle édition, son rénové, texte passionnant, mais paresse certaine par ailleurs : pas de dates d’enregistrement, oublis des solistes vocaux, il fallait être à l’heure pour l’anniversaire ! (Jean-Charles Hoffelé)
 |