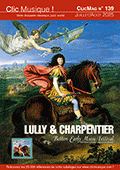L’œuvre pour piano de Robert Schumann (1810-1856) composée avant la trentaine, a ceci de caractéristique quelle émane de l’univers fantasmatique du compositeur allemand alors qu’il décide de se consacrer à l’écriture musicale. A la fois tendre ou lunaire Eusébius et brillant ou facétieux Florestan, Schumann lui-même aime à peindre des miniatures sonores où se cachent les portraits de son entourage et ce style, à nul autre pareil, le poursuivra. Ainsi en 1837 dans les "Davidsbündlertänze" op. 6 – danse des compagnons de David – Schumann ouvre par une tendre mazurka citant sa muse Clara Wieck, chère Chiarina du Carnaval composé deux ans plus tôt et rend hommage, à notes couvertes, à l’ami Frédéric Chopin qui concomitamment compose ses préludes : Nous pourrions y voir un subtil jeu de miroirs ! Tout comme, écoutant les similitudes de temps et d’élans romantiques de la sonate pour piano en fa m. op. 14 de 1836 qui porte le souffle d’un "concerto sans orchestre" avec la sonate en Sib m. de Chopin dont Schumann disait, et aurait pu dire de son œuvre : "Ce serait caprice d’appeler cela sonate, si ce n’était orgueil d’avoir ainsi accouplé quatre de ses enfants les plus fous" ! Ces deux monuments schumanniens sont admirablement mis en scène par le pianiste allemand Gerhard Oppitz qui, avec la sagesse de l’âge, nous donne une leçon de musique prodigieuse de lyrisme, de ligne mélodique, de regard sur l’horizon comme une rêverie du temps qui passe, où chaque note appelle la suivante, chaque registre répond à l’autre, d’un son jamais clinquant mais toujours nimbé de retenue, ambré d’énergie et… "Wie aus der Ferne" - comme venu du lointain - Eusébius et Florestan nous apparaissent… Remarquable ! (Florestan de Marucaverde)  Within the realm of Romantic piano music, where new discoveries are constantly just around the corner, the contribution of Robert Schumann has always played a major part. True, he cannot rival the aura of Chopin’s works, of which ??gnaz Friedman asserted that not only had Chopin opened the piano with them, he had closed it again. (Schumann paid his own tribute in his reverent review of Chopin’s op. 2 of 1831, the Variations on Mozart’s “Reich mir die Hand, mein Leben”). Nor did Schumann embed in the history of piano playing such milestones of technical mastery and manual dexterity as Liszt who – inspired by Paganini’s concerts and enabled by the double-escapement action developed by Sébastien Erard in 1821 – had practically reinvented the instrument by the time he wrote his Etudes d’exécution transcendante in 1837. And neither the sprightliness of Felix Mendelssohn’s keyboard idiom nor Charles-Valentin Alkan’s exaltation of virtuosity are characteristic of Schumann’s piano music, even if he proves in his Abegg Variations op. 1 (1830) and his Toccata op. 7 (1832) that he brilliantly commanded both approaches to the instrument.
 |