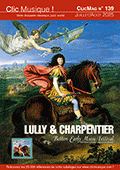Schumann fut intensément tiraillé entre l’écrivain et le compositeur. A la vocation qui l’emporta, l’autre, son double, allait en quelque sorte remettre ses forces inemployées. Plus encore que ses prédécesseurs, ce volume conclusif de l’Œuvre symphonique montre qu’en effet jamais le poète ne cessa de parler dans la voix du musicien. Mais le poète parle afin de révéler que « l'homme n'est pas seul à parler,l'univers aussi parle, tout parle » (Novalis). Schumann consacra cet idéal en laissant remonter dans les sons les forces obscures et indicibles de la nature présentes dans les drames de Byron, Goethe, Schiller, Shakespeare. Holliger en restitue toute les tensions dans une direction d’une justesse et d’une vérité troublantes. Manfred trouve enfin la paix après avoir franchi les portes de la mort pour rejoindre Astarté. Holliger exaltant le rôle déterminant de l’orchestration, des contrastes de dynamique, des silences dans la progression dramatique de l’ouverture, l’auditeur se laisse rapidement gagner par la passion et le mystère avant d’accueillir l’annonce du dénouement avec émotion. La valeur expressive de l’interprétation se retrouve dans l’ensemble des autres pièces, beaucoup plus rarement jouées. Datant de 1853 comme le concerto pour violon, l’ouverture des « Scènes du Faust de Goethe » devait être la dernière ou l’avant-dernière œuvre orchestrale de Schumann. De la symphonie en sol mineur seul le premier mouvement fut joué du vivant du compositeur, en novembre 1832 à Zwickau, puis en 1833 en février à Schneeberg et en avril à Leipzig où avait été créée en décembre 1832 l’unique symphonie achevée de Wagner. Plus méconnue et pourtant plus attachante que celle-ci, la symphonie de Schumann devra attendre un siècle pour la création de ses trois premiers mouvements, le scherzo alors complété, le final demeurant à l’état d’esquisse. Bien que parcourue comme par secousses de fatales réminiscences beethovéniennes, héritage toutefois moins préjudiciable qu’à la symphonie de Wagner car distribué ponctuellement, la phrase schumannienne entame la rupture avec les carrures d’essence plébéienne et jupitérienne par sa respiration ondoyante plus complexe. La singularité de l'élocution est déjà manifeste. La véhémence et l’urgence de Gardiner restant inégalées, Holliger a le mérite d’avoir su légitimer une esthétique opposée. Son intériorité finit par se confondre avec l’apparente irréalité du rêve nocturne. Les contours s’estompent mais bien réel est notre souvenir de la confusion entre rêve et réalité dramatisée comme équation sans solution dans certains Contes Fantastiques de Ludwig Tieck, auteur très apprécié de Schumann. Sitôt découverte ou redécouverte cette œuvre alors si prometteuse, on se dit qu’un septième volume aurait permis d’entendre les deux concertos pour piano inachevés et les Variations sur un thème de Paganini, mais peut-être Schumann nous aurait-il confié que tout ceci n’était qu’erreurs de jeunesse. (Pascal Edeline)  Concluding audite's Schumann edition, this CD combines the first symphony with the late overtures, whose compactness displays the composer's symphonic mastery. The overtures, all written after 1847, represent an essential complement to the symphonies: seen in relation to the symphonies, they take a similar position as do the Konzertstücke relative to the concertos. Schumann conceived them partly as preludes to operas, oratorios or incidental works, partly as independent pieces. On the one hand, they were intended to provide "an image of the whole"; on the other, their purpose was to introduce, leading into the drama. Beside larger- and smaller-scale vocal works, and alongside the poetic renewal of the symphony, they bear testimony to the great significance of literature in Schumann's musical thought and style. The overtures are supplemented with Schumann's first symphony, the so-called "Zwickau". It was the composer's first attempt in the symphonic form to be performed publicly, even though the work remained incomplete.?
 |