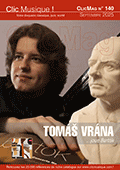Lanzetti, considéré, de son vivant, comme l’un des plus grands violoncellistes napolitains, mena une carrière de soliste à Turin, parcourut l’Italie et l’Europe, séjournant longuement à Londres, se produisant à Paris (1736 notamment), ainsi qu’à Amsterdam et à Berlin… Toutes ses compositions (sonates éditées ou restées, pour certaines, manuscrites) sont dédiées au violoncelle. Auteur d’une méthode, il apporta des innovations notables à la technique de jeu, inventant des coups d’archets, inaugurant l’utilisation du pouce comme capodastre. À peu près oublié, il fut redécouvert en 1982 par C. Ronco, qui eut sous les yeux à la bibliothèque du conservatoire de Turin les microfilms de la 2e édition de son opus 1, provenant de la Bibliothèque Nationale. Passionné par cette musique, Ronco lui a consacré, outre plusieurs enregistrements, des articles, des études, des interviews… La particularité de cette "nouvelle" interprétation tient au choix radical qui préside à la réalisation de la basse continue : alors que d’autres interprètes (les enregistrements de Lanzetti se sont récemment multipliés) la confient au clavecin, voire à l'orgue et à un autre violoncelle - Ronco fit de même précédemment - l'étude approfondie des partitions l’a convaincu que ces œuvres étaient - dans leur essence - idéalement écrites pour deux violoncelles, et que « les autres instruments communément utilisés comme continuo, pouvaient être facilement éliminés » (je traduis). Cette « réduction », loin d’assécher ces œuvres, de leur conférer une austère abstraction, d’en faire pâlir les couleurs, les magnifie, les exhausse, fait admirablement ressortir leur virtuosité (plus prononcée dans les sonates 7 à 12 que dans les premières) et les enrichit. L’extraordinaire pluralité rythmique, la diversité surprenante dans l’enchaînement des affects (passages de la délicatesse, du caractère pastoral et galant au dramatisme, à la méditation, à la plainte) les contrastes, chromatismes et ruptures prennent un aspect saisissant, voire hallucinant dans ces jeux de reflets des deux instruments — à la fois mêmes et autres. Il y a là une densité d’une tout autre nature que celle produite par la variété de timbres différents, une mise à nu qui n’est jamais dénuement, mais élan vers une plénitude sans égale qui porte en elle l'entier et pur éclat de cette surprenante musique. Défi considérable mais relevé avec quel panache ! À écouter d’urgence. (Bertrand Abraham)  Thirty years afer the first world recording, Claudio Ronco concludes his research on Lanzetti’s Sonatas, and this time chooses to propose them to two single cellos, in their maximum essentiality, as the Duport brothers or the Jannson would certainly have preferred in the second half of the Eighteenth century, at the dawn of Classicism, exalting the many qualities of their instrument and thus paying homage to the great Neapolitan cellist school of which they were heirs. On the other hand, all the European cello schools could be said to be emanations of that Neapolitan school, and Salvatore, at that time, was its most famous representative following the legendary Francischello, born in Naples in 1691 and died in Vienna in 1739, of whom he could rightly be considered the successor. Although proposing this music with two single cellos can be considered the simplest and leanest of the various performance possibilities, as soon as we want to offer the listener an interpretation capable of revealing the greater density and complexity of the work, it is immediately reversed in the most difficult choice, because it imposes and demands from the couple of performers the maximum technical and expressive virtuosity.
 |