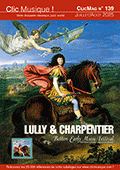Disque attachant, qui entoure deux cycles de lieder dans des habillages chambristes par des pièces emblématiques du renouveau musical au début du XXe siècle elles aussi recomposées pour petit ensemble. Ce chemin vers l’intime à rebours, débuté chez Debussy, terminé chez Mahler, pourrait se résumer dans la Berceuse élégiaque de Busoni : son balancement morbide, ses couleurs sombres et pourtant luminescentes qui évoquent le symbolisme, donnent le ton de cet album étrange où Dietrich Henschel s’approprie les Maeterlinck Lieder de Zemlinsky, réservés aux mezzo-sopranos. Voila une extension de répertoire du baryton que même Dietrich Fischer-Dieskau n’avait pas tentée. Dietrich Henschel les fait sien avec cet art diseur, ce timbre subtil, cette intelligence des émotions, mariant ses timbres avec les vêtures instrumentales artistement composées par Erwin Stein et Reinbert de Leeuw. Pivot du disque, les Zwei Sätze für Streichquartett composées par Zemlinsky en 1895, sont encore immergées dans l’ultime romantisme de Brahms, une année plus tôt Debussy inventait la Musique Moderne avec le Prélude à l’après midi d’un faune : collision des styles qui parait soudain invraisemblable et remet quelques pendules à l’heure : l’école de Vienne était encore à venir. Dietrich Henschel referme l’album avec les Lieder eines fahrenden Gesellen justement dans l’habillage instrumental légèrement décalé dont les revêtit Arnold Schœnberg. Voix plus légère qu’à l’habitude, sans pathos, animant le texte, lecture transparente qui illustre tout l’art de ce chanteur-poète trop rare au disque (Discophilia, Artalinna.com). (Jean-Charles Hoffelé)  Dans les années 1900 s'opérait à Vienne le déclin de la fameuse Apocalypse « joyeuse » selon l'essayiste Jean Clair. Austérité et tendances suicidaires succèderent brutalement à l'insouciance et les dorures de l'époque impériale. Rupture des codes et des formes : Kandinsky en peinture et Schöenberg en musique inventaient de nouveaux concepts. De même que la peinture abstraite de l'artiste russe sera qualifiée bien plus tard de dégénérée, la musique dite atonale du compositeur austro-hongrois n'a pas du tout la faveur du public et des concerts. Schöenberg doit alors fonder avec ses élèves Berg et Webern une association afin de pouvoir jouer et diffuser leur propre musique ainsi que celle de leurs contemporains. Mahler, Reger, Richard Strauss, Debussy, Bartok furent au programme de ces concerts privés. Les œuvres orchestrales étaient réduites pour un effectif de chambre et arrangées par Schöenberg et ses élèves, Erwin Stein et Benno Sachs. On découvre dans ce disque de l'ensemble Oxalys les arrangements de quelques œuvres importantes de l'époque : le "Prélude à l'après-midi d'un faune" de Debussy a perdu de sa volupté charnelle dans cette cure d'amaigrissement. Schöenberg choisit d'arranger les "Lieder eines fahrenden gesellen" de Mahler car il y appréciait le raffinement et le lyrisme de l'orchestration. Oxalys les radiographie en injectant de la couleur dans chaque pupitre. Henschel y déploie un jeu, un feu souverain. Idem pour les "Sechs Gesänge" d'Alexander Zemlinsky, conçus pour petit ensemble, leur structure harmonique multicouche n'empêche nullement l'expressivité des poêmes de Maeterlinck, portée par la voix fougueuse du baryton. Du même compositeur, deux mouvements du quintette, joués avec le même cocktail de souplesse et de rigueur, révèlent franchement l'héritage de Brahms. La ténébreuse "Berceuse élégiaque" de Ferrucio Busoni est la pièce la plus emblématique de ce processus de réduction. Comme en cuisine, où le jus se transforme en suc à la cuisson, la masse des cordes de l'œuvre originale a été épannelée par Erwin Stein au profit d'une meilleure lisibilité et d'un discours plus dense. Elle perd de sa pulpe morbide pour gagner en os. Programme passionnant, formidablement interprété par les quatorze musiciens de l'ensemble belge Oxalys et par le baryton Dietrich Henschel, dont l'articulation et le timbre rappellent étrangement Fischer Deskau, autre "compagnon errant ", lui aussi expert dans ce répertoire. (Jérôme Angouillant)
 |