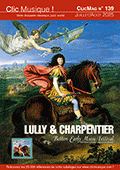Spohr, cet autre Weber qui aura eu le seul tort d’une certaine longévité (75 ans), composa d’abondance, si bien que des pans entiers de son catalogue durent patienter longtemps avant de revoir le jour. Cause aujourd’hui entendue et surtout cause gagnée pour les Concertos de violon, les Symphonies, la musique de chambre, certains oratorios même, mais les Lieder ? Pourtant, Dietrich Fischer-Dieskau lui-même inscrivit à ses récitals très tôt des lieder de Spohr et finalement en 1984 choisit de lui consacrer un plein album, joyaux oubliés de sa grande série pour Orfeo. Il y divinise les merveilles suggestives (Erlkönig !) de l’opus 154, où la diction se rappelle des ballades ancestrales : il faut aussi narrer, qui le pourrait mieux que lui ? Spohr est gourmand, il demande aussi un violon, son instrument péché mignon, Fischer-Dieskau aura convaincu Dmitry Sitkovetsky d’y mettre son archet un peu amer. Quel alliage ! Puis il herborise dans les lieder épars, cherchant les gemmes étranges, comme ce Zigeunerlied de loup-garou croqué en une minute. Et si Spohr était un génie finalement ? Merveille, il entraine ici Julia Varady, son épouse à la ville, pour les six Lieder l’opus 103, vrai cahier romantique absolument weberien, où se mêle au timbre d’agate de la soprano la clarinette d’Hans Schöneberger. « Stil mein Herz » pourrait être un air d’opéra, « Das Heimliche Leid » une invocation avec un drame en récitatif. Trente quatre ans plus tard ce disque, prophète malgré lui, proclame toujours dans le désert. (Discophilia - Artalinna.com) (Jean-Charles Hoffelé)  Pour les mélomanes, le premier XIXème siècle est dominé par les figures de Beethoven et de Schubert. Ces deux géants ont éclipsé d’estimables compositeurs comme Ludwig Spohr, qui laissa entre autres des symphonies, des quatuors et une centaine de Lieder. Outre le piano, le violon accompagne les mélodies dévolues au baryton, et la clarinette celles dévolues à la soprano. Au milieu des années 1980, Fischer-Dieskau a construit sa monumentale discographie. Dans les marges du répertoire allemand, on l’entend plus libre et plus naturel. La soixantaine n’a rien altéré des qualités fondamentales de la voix. Au contraire, le timbre est au sommet de sa beauté, et la palette de nuances semble infinie (la mezza voce dans le Schlaflied !). Julia Varady est dans son plus beau printemps. La technique est au-dessus de l’éloge, le timbre ensorcelant. Son Wiegenlied justifie à lui seul l’achat de ce disque. Le piano sensible et rêveur d’Hartmut Höll est un luxe supplémentaire. Une indispensable redécouverte. (Olivier Gutierrez)
 |