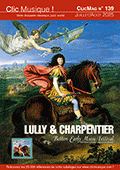Hongrois proche de la culture italienne (il complète son parcours académique à Rome), Ferenc Farkas (1905-2000) compose, dans les années 1930, de nombreuses œuvres pour le cinéma, le théâtre et la radio, en même temps qu’il s’intéresse, à la manière de Béla Bartók et de Zoltán Kodály, à la musique hongroise traditionnelle : il part un temps à la chasse aux chants populaires du comté de Somogy, avant d’enseigner dans différents conservatoires et académies (parmi ses élèves, le duo des György, Kurtág et Ligeti). Le catalogue complet de ce compositeur au langage influencé à la fois par le néo-classicisme italien, le folklore hongrois et le dodécaphonisme comprend plus de 700 œuvres et ce disque en rassemble celles pour le piano. Trois d’entre elles datent du séjour italien de Farkas : la Sonate, "Quaderno Romano" (six petites pièces, chacune dédiée à un ami hongrois vivant à Rome, dont les titres reflètent l’humeur de ce carnet de notes romain) et "Canephorae" (une référence athénienne aux nobles porteuses de panier des fêtes religieuses) ; le cycle "Hybrides", plus tardif, est influencé (alors que le compositeur s’attache le plus souvent à proposer une musique accessible) par le sérialisme de Pierre Boulez – ou plutôt son versant souple, proposé par Luigi Dallapiccola. (Bernard Vincken)  Hongrois Ferenc Farkas ? Certes, cet élève tôt décillé -adolescent déjà il avouait une fascination pour Schoenberg – du très conservateur Leo Weiner, fut un pur produit de l’Académie de Musique de Budapest, mais à vingt-quatre ans, direction Rome, où son langage va prendre forme. Il reviendra à l’atonalisme (et se convertira à un "dodécaphonisme tempéré"), pour l’heure la découverte de Scarlatti et les influences de Casella et des modernes italiens immergent sa Première Sonate dans une vive lumière dont les aspérités ne sont pas absentes. L’harmonie se tend, et l’écriture se fait par moment ardue avant que quelques motifs scarlattiens ne viennent tempérer. Le premier volume de ce que l’impeccable Stefano, Cascioli annonce comme une intégrale, ratisse large, de quelques opus romains aux partitions plus radicales des années cinquante (mêmes les Hybrides dont chaque mouvement porte un titre italien faisant référence au Baroque n’y échappent pas), avant de célébrer le style de synthèse élaboré par un compositeur octogénaire. La difficulté est de faire passer inaperçu les automatismes d’un langage en reflexes et les recherches abstraites qui emplissent progressivement la syntaxe d’un compositeur qui perd au piano les couleurs de ses opus d’orchestre. Stefano Cascioli y parvient avec un vrai sens musical, faisons lui confiance pour approfondir les opus restant. (Discophilia - Artalinna.com) (Jean-Charles Hoffelé)  After deepening the piano works of Francesco Pennisi, Stefano Cascioli undertakes the exploration of the work of the Hungarian composer Ferenc Farkas (1905-2000). He now comes out for Stradivarius Farkas and Italy. Baroque suggestions, first volume of the series with the publication of the integral for piano. The Hungarian composer Ferenc Farkas (1905–2000) had particularly close ties to Italy. This, however, was not only of decisive importance in his career but also an influence on the development of Hungarian music history through his students, which even indirectly left a mark on European music. Farkas was the head of the composition department of the Budapest Academy of Music from 1949 to 1975, and his class produced such excellent composers as György Ligeti, György Kurtág, Emil Petrovics, Sándor Szokolay, Miklós Kocsár, Zoltán Jeney, Zsolt Durkó, and Attila Bozay. His legendary lessons played an important role in turning the interest of Hungarian composers toward Latin culture and loosening the grip of the German influence that lasted for centuries. Farkas followed Respighi’s example both in his approach and in his referencing the musical past, but in terms of style Alfredo Casella and Gian Francesco Malipiero were closer to him. His songs and chamber works were soon successfully presented in the Italian capital, where the Teatro Indipententi performed the comedy of Amelia Della Pergola (stage name Diotima) Non ci sono più donne with his music on March 15, 1930.
 |