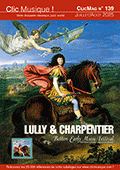L’âge d’or du violon italien empli le XVIIIe Siècle de Venise à Naples, dispersant ses virtuoses compositeurs dans toute l’Europe. Marie Rouquié réuni sur ce disque modeste et secret le maitre et l’élève, Giuseppe Tartini et Pietro Nardini, cherchant dans les opus moins courus que le Trille du diable, à composer un portrait plus juste de celui qui ne fut pas qu’un virtuose. Elle fait bien entendre ce cantabile vocal qui faisait d’abord le pouvoir de séduction de Tartini, et magnifie de son violon anonyme du 17éme Siècle les arabesques ornées de ce chant qui pourrait être celui d’Orphée : le Largo de la Sonate op. II n° 2 résume tout cet art. Josèphe Cottet lui répond en jouant un rare violoncelle da spalla, vraie voix humaine qui donne à l’ensemble une saveur harmonique et des couleurs ambrées plus d’une fois saisissante. La liberté du discours, le caractère des phrasés, le sens du « ballo » dans les allegros, soulignent les inventions de cet art qui prenait d’assaut l’Europe, instrument d’une révolution dont Paganini sera l’ultime génie. (Discophilia - Artalinna.com) (Jean-Charles Hoffelé)  Il est des répertoires qui nous emmènent au-delà de nos habitudes…. Aborder Giuseppe Tartini, c’est tout d’abord constater une incohérence : ce personnage si incontournable à son époque, violoniste virtuose, compositeur prolifique, pédagogue de grande envergure, est très peu représenté de nos jours. Or, celui qu’on appelait le « maître des nations » et qui a formé les plus grands violonistes de l’ère classique nous laisse une école de violon surprenante et originale, ainsi qu’un corpus de compositions sur le violon qui n’a pas encore livré tous ses trésors… Pour Giuseppe Tartini, l’objectif est singulier, et clair : dompter, maîtriser, et provoquer le plus souvent possible ce « petit quelque chose » qui fait que l’on est ému en écoutant de la musique ; ce moment que l’on réécoute mille fois et qui, à chaque fois, nous fait le même effet, et qu’il appelle la « rencontre avec la vérité de la nature » (« la verità di natura »). C’est pour moi ce qui donne une valeur exceptionnelle à l’œuvre de Tartini : elle fait appel à l’intellect, au jugement, aux capacités instrumentales de l’interprète, mais son but vise quelque chose de beaucoup plus viscéral, instinctif, presque « premier », que tout le monde semble posséder en soi. Elle est à la fois accessible et pointue. Certains ont écrit que c’est l’une des définitions d’un chef-d’œuvre. L’objectif est singulier, mais les moyens pour y parvenir ne le sont pas moins : la problématique expressive est traitée de manière exceptionnellement globale. Chez Tartini tout se mélange : les trilles garantissent la suavité et les longueurs d’archet créent la virtuosité, les mouvements « lents » égrènent des notes très rapides alors que les mouvements vifs demandent une poésie intérieure permanente... Ainsi, tous les moyens détenus par le violoniste sont sollicités en permanence : l’invention, le savoir, la sensibilité et l’agilité se mettent au service de l’archet, qui centralise toutes ces données et crée le geste musical. À notre époque de réalité augmentée, j’avais presque envie de parler d’« archet augmenté », jusqu’à ce que je relève l’indication que Jean-Baptiste Cartier a ajouté à « l’Arte del arco » de Giuseppe Tartini, dans la seconde édition de son Art du violon : ARCO MAGNO Un des objectifs de cet enregistrement est de faire entendre quelques exemples choisis d’une pratique essentielle, tant dans l’œuvre tartinienne que pour le style baroque en général, encore timidement représentée sur la scène discographique : ce que Tartini appelait la « cantabilità strumentale », ou l’art d’orner les mouvements lents. Les mouvements lents tels qu'ils nous sont parvenus dans les éditions du XVIIIe siècle manquent de la cohérence avec les autres mouvements dont Tartini parle dans ses « regole » (« eguaglianza ») : l’écriture est souvent trop simple, et semble incomplète au regard des mouvements rapides qui suivent. A contrario, les sources manuscrites comportent, elles, de nombreuses versions ornées. J’ai donc utilisé ces propositions le plus possible, en écrivant moi-même les compléments nécessaires quand il le fallait. Une fois cette cohérence rétablie, la sonate fait peau neuve et retrouve une complétude d’affects plus consistante. Les quatre pièces de Giuseppe Tartini gravées ici dépeignent chacune une époque de sa vie : Le concerto est une œuvre de jeunesse, que Tartini décrivait comme « alla bravura », (« à la bravoure ») : ou le style de jeu très virtuose qu’adoptent souvent les jeunes violonistes. La sonate en sol majeur fait partie de l’édition de Le Cène, corpus diffusé dans toute l’Europe et qui a forgé la réputation du maître. L’adagio est un sommet de l’art de chanter sur le violon, dans lequel le chant original « Alma dell’ alma mia » est développé d’une manière presque excessive, faisant appel aux plus grandes capacités violonistiques de l’interprète. Enfin, la sonate qui commence ce disque fait partie d’un des derniers corpus écrits par Giuseppe Tartini, resté manuscrit, que l’on appelle les « piccole sonate ». Ces sonates, écrites pour un effectif très réduit – la partie de basse est très simple et spécifiée facultative par l’auteur –, proposent une synthèse admirable du style tartinien, où la cohérence dans l’écriture des mouvements et la sobriété de la forme permettent d’accéder directement à son essence très personnelle. On ne doit pas oublier que Giuseppe Tartini a arrêté de voyager tôt pour se produire uniquement à Padoue et consacrer la majeure partie de sa carrière à l’enseignement. Chez Tartini, on apprend le violon pour deux florins par mois, trois florins si on veut également étudier le contrepoint. Son école est très réputée et attire les meilleurs violonistes d’Europe : Pasquale Bini et Emanuele Barbella d’Italie, Pierre La Houssaye et André-Noël Pagin de France, Friedrich Rust d’Allemagne, Tommaso Linley d’Angleterre… autant de violonistes qui seront des figures centrales du style classique en Europe. Pietro Nardini (1722-1793) , est l’un des plus grands défenseurs de l’école de son maître. Originaire de Livorno, il a été le premier violon de l’orchestre de Jommelli à Stuttgart, avant de revenir à Florence. Sa sonate en sol mineur propose ce mélange d’influences typique des œuvres de cette époque : après un adagio orné époustouflant de théâtralité, le deuxième mouvement détient le sérieux de la rhétorique baroque, avant que le troisième nous emporte dans ses résonnances de danse traditionnelle. Quant au petit Cantabile, il s’agit d’une feuille volante qui s’est échappée d’un recueil de sonates que j’étais en train de cataloguer. Un adagio orné seul, sans basse… Nous n’avons pas encore identifié à quelle sonate il pourrait correspondre, nous avons donc écrit une basse. Il est frappant de constater à quel point les ornements utilisés dans ce cantabile sont similaires à ceux de la sonate, tout en évoluant dans un caractère fondamentalement opposé : serein et optimiste. Un mot sur l’instrumentarium utilisé ici : Tout comme Giuseppe Tartini, qui jouait avec son grand ami Antonio Vandini, j’ai élaboré ce projet avec des partenaires de longue date, car la poésie omniprésente de ce répertoire demande une grande malléabilité que seules de nombreuses heures de pratique commune peuvent permettre. En plus du clavecin, c’est donc le violoncello da spalla qui donne la réplique au violon. L’utilisation de cet instrument riche en harmoniques aigües donne une cohérence de son que je trouve assez unique : quatre cordes graves ajoutées aux quatre cordes habituelles du violon. Il est évident que cet art de la vocalité instrumentale faisait partie du vocabulaire maîtrisé par les multiples élèves du Maestro delle Nazioni ; ces pages révélées illustrent à merveille l’inclusion de cette pratique dans le XIXe siècle qui s’annonce, si bien qu’on croirait déjà voir Chopin au bout du chemin…
 |