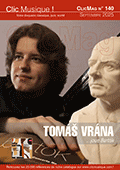Les Ballets Russes de Diaghilev et ses danseurs vedettes Massine et Nijinsky qui se produisaient en 1913 à Berlin, donnèrent à Richard Strauss, l'idée de composer un ballet pantomime : La Légende de Joseph. L'argument en fut écrit par deux librettistes : H.V. Hoffmanstal et H.G Kessler. Strauss avait déjà exploré l'orient fantasmatique avec son opéra Salomé (1911). Il récivide avec un de ses thèmes de prédilection : l'amour entre une femme mure et un jeune homme. La femme de Potiphar symbolise un monde de luxuriance, de beauté, d'hédonisme alors que Joseph est garçon immature, rêveur et enthousiaste. Strauss reprend les schèmes formels (dont la danse) qui prévalaient dans ses opéras précédents Ariane et le Chevalier à la Rose, mais sous forme de bribes (le ballet comporte 26 numéros assez courts), toutes plus ciselées les unes que les autres. L'orchestre a d'ailleurs été élagué et comporte outre un piano, un celesta, 4 harpes, et une section importante de percussions. On retrouve le Strauss créateur d'ambiances en technicolor usant de tous les feux d'un l'orchestre même réduit, pour animer chaque épisode du livret et faire d'un spectacle visuel (un ballet) un spectacle total. Cette musique d'une transparence et d'une vivacité roborative s'accorde tout à fait avec la gestique des danseurs. Stefan Solyom dirige un orchestre parfaitement en phase avec la richesse orchestrale et la conception scénographique de l'œuvre. (Jérôme Angouillant)  The Chaste Joseph in the Grips of Décadence During a guest performance in Berlin in 1913 Richard Strauss saw Sergei Diaghilev’s Ballets Russes and was so delighted by them that he declared his readiness to compose the ballet pantomime Josephs Legende (Joseph’s Legend) for this extraordinary ensemble. The librettist Hugo von Hofmannsthal had also become acquainted with the Ballets Russes as »the practically unlimited pleasure of pure sensuous joy.« The story of the Joseph legend was not new territory for Strauss inasmuch as the Bible and the Orient had previously supplied him with material for his Salome. Moreover, the subject matter offered yet one more variation on an old Strauss theme: love between an older woman and a youth. Potiphar’s wife belongs to the magnificently sultry world of wealth and power and feels sexual desire for an unspoiled shepherd boy, a dancer and a dreamer, who »has not yet been together with a woman.« To depict the sumptuous sound world of the Orient, Strauss exploits all the resources the late-romantic orchestra has to offer. Instead of producing a mixed sound, however, he relies on harsh contours. This is music full of clarity, mental acuity, and immediacy of expression.
 |