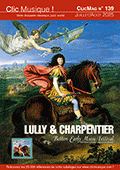Georg Muffat compositeur allemand d’ascendance écossaise, fut élève de Lully puis se familiarisa avec le style de Corelli à Rome. Il finit sa carrière maître de chapelle de l’évêque de Passau. Son rôle fut crucial dans la transmission des styles français et italien en Allemagne. Son œuvre est instrumentale : sonates (l’Armonico Tributo 1682), douze concertos grosso, des suites orchestrales et un recueil de pièces pour orgue (l’Apparatus Organisticus 1690). Son style cultive donc les deux courants français et italien mais son influence majeure est Corelli et Pasquini (héritier de Frescobaldi) que Muffat nomme respectivement « l’Orphée et l’Apollon d’Italie ». S’il s’inspire délibérément de l’œuvre de Corelli, Muffat en renouvelle les principes d’exécution. Les préfaces de ses partitions fourmillent de milles annotations indiquant les conseils pratiques utiles au musicien. Prise de l’archet, tenue des notes, tempos, ponctuation et équilibre des parties. Muffat, inspiré par l’école française, ajoute des vents aux cordes, viole, harpe et théorbe au continuo et ajuste les effectifs instrumentaux afin d’obtenir de plus beaux effets de timbres et une plus grande clarté sonore. / C’est cet aspect que les musiciens de la « Concordanza » ont choisi de rendre. Une splendide perspective sonore, magnifiée par la prise de son, détaille chaque instrument d’époque séparément, en respectant l’équilibre continuo vents et cordes. L’ensemble prend son temps, respire et sonne ample, laissant infuser cette magie du mélange des timbres. Las, la dynamique est paresseuse et cette majesté sonore verse peu à peu, au fil des mouvements, dans une rêverie languide. Les tempos adagio, graves qui se succèdent réclament un influx moteur, une articulation plus affirmée. La chaconne du concerto XII se traîne (si on la compare à la version déjà ancienne de Shepherd et de Cantilena (Chandos). Seule pièce de chambre du disque, la sonate pour violon solo est de goût italien et rappelle clairement par sa virtuosité et la richesse de sa composition, les « durezze » de Pasquini (dissonances, emploi de l’enharmonie, écriture fuguée) elle est exécutée avec une fougue revigorante par Stefano Rossi. On apprécie la sensualité et la tendresse de cette version. Le fait que l’ensemble soit composé pour moitié de femmes et dirigé du clavecin par Irène de Ruvo n’y est pas étranger. (Jérôme Angouillant)
 |