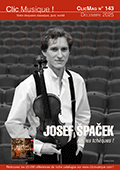Les années soixante pour Martina Arroyo c’est l’époque bénie. Le Met l’a vu triompher en 1965 en Elizabeth de Valois, elle incarne Amelia, la Leonora de la Forza del destino, elle est devenue le grand soprano verdien qu’elle rêvait d’être. Cette diva du MET existait alors que Leontyne Price régnait, mais elle rayonnait absolument. Avant de faire carrière aux USA, elle avait longtemps fréquenté les théâtres d’Europe, Italie, Allemagne essentiellement, y faisant ses classes, y apprenant son métier, apprivoisant la scène mais aussi le récital. Car seule de son rang et de ses origines dans sa génération, elle se voulut récitaliste. Avant elle et parmi les sopranos noires, seule Marian Andersson le fut à ce degré d’intelligence, et dans une acceptation aussi polyglotte. La Liederabend captée à Schwetzingen illustre cela à merveille, qui commence chez Rossini et fini par quatre spirituals parmi ceux qu’affectionnaient particulièrement Marian Anderson, justement. Mais le centre est tout entier purement dévolu au Lied. Sommet les Zigeunermelodien de Dvorak dont elle magnifie la traduction allemande. Mais les Schubert – Ganymed au pas si noble, - et les Brahms choisis parmi les Mädchenlieder sont tous aussi splendidement animés par cette voix de miel, pleine, solaire jusque dans ses ombres. Style parfait, art souverain que relaie le clavier orchestre de Leonard Hokanson, un des tous grands accompagnateurs de son temps trop oublié. Soirée bénie (Discophilia - Artalinna.com). (Jean-Charles Hoffelé)  Complicité du piano et de la voix, de Léonard Hokanson et de Martina Arroyo : c'est l'impression première, et confirmée, que donne ce récital : ils rient ensemble, méditent ensemble, voire prient ensemble dans quatre spirituals intériorisés ou joyeusement désinvoltes. Une fois soulignée l'insolence spirituelle du pianiste ou sa gravité sobre et prenante, reste à admirer la somptueuse voix d'une chanteuse, habituellement déployée dans le grand opéra verdien et qui, ici, se discipline, se modèle, dirait-on, pour s'ajuster exactement à ce qu'elle exprime, quitte à s'épanouir au gré des élans du texte. Dvorak est servi de façon exemplaire dans la diversité des Mélodies tziganes, les Chansons de fillettes de Brahms ont la légèreté voulue, et l'on se hasarde même dans Rossini, pour une Danza à la virtuosité inattendue, avant de retrouver l'ample ligne romantique de Schubert. Un témoignage unique, dans tous les sens du mot, hélas !, au Festival de Schwetzingen, 1968, de ce que peut faire une grande voix. (Danielle Porte)
 |