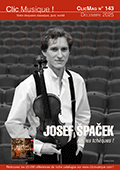L'esprit belge est là, placé sous le signe de l'humour qu'a toujours eu outre Quiévrain le surréalisme : si le clin d'œil du titre au « Ceci n'est pas une pipe » de Magritte est évident, la perspective du compositeur est ludique, dépourvue d'arrière-pensée métaphysique. Elle procède d'une dérive imaginative et fantaisiste prolongeant à sa façon le style « fantasticus » baroque. Cette musique pourra rappeler des œuvres du XXe siècle passablement oubliées aujourd'hui — inspirées à des compositeurs tels que Ligeti, Xenakis, Mâche, Risset, Gorecki, etc., par la formidable claveciniste que fut E. Chojnacka, et qui influencèrent la facture et la façon d'exploiter l'instrument — mais le propos est tout autre : Huys utilise une copie d'instrument historique, sa « non-passacaille » fut au programme de l'officiel concours international de clavecin de Bruges dont ce professeur et membre d'ensembles baroques fut la cheville ouvrière. Revendiquant ouvertement l'éclectisme de ses compositions, il joue avec des formes de la tradition (toccata, « tombeau » …). Son écriture a peu à voir avec, par exemple, l'abstraction sérielle. Ses pièces assemblent, enchaînent, opposent ou varient, dans une trame qui procède toujours quelque part de l'énonciation « baroque », des séquences convoquant musique répétitive, jazz (boogie-woogie notamment) éléments renvoyant à Debussy, à Satie, traits virtuoses virevoltants. Certaines pièces exploitent avec facétie des singularités liées à l'histoire de la musique : ainsi une étude pour la main gauche, première du genre pour le clavecin, ou une fantaisie qui joue sur l'intervalle du triton, le diabolus in musica, proscrit dans la musique ancienne. C'est sans prétention, intelligemment amusant, cela mérite d'être écouté. (Bertrand Abraham)
 |