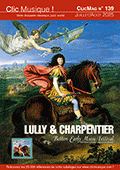Que cette affaire n'ait pas de rebondissement, plaisantait ce prof en confisquant au vol notre baballe chahutant un cours au magistère un peu trop assis. Le Bach que voilà (un ''austère qui se marre'' ?), c'est tout le contraire : jaillissement et rebond, un vrai rythme tenu, et de l'audace dans les différentes attaques (il goûtait fort les gambistes français), étant permis de rappeler à beaucoup que ces suites sont d'abord des danses. Mais alors, d'entrée de jeu, le prélude de la première suite nous paraît ici un peu trop fluctuant, désarticulé, assurément trop lent, auquel il manque précisément cette métrique assurée qui ferait qu'il danse. Terrain aplani, adouci, doux valonnements dont on attend en vain la surrection de décidés contreforts. Idem de l'allemande de la quatrième, qui pourrait oser se déboutonner, comme de sa bourrée un soupçon empesée. Et encore, toute la deuxième suite, morne plaine aux tons effacés : du pastel où l'archet semble refuser l'engagement. Après quoi heureusement c'est toute la troisième qui enfin, bien établie sur un excellent prélude, frétille par dessus la gambette, tandis qu'en conclusion la sixième frôle en cela la perfection. Mais là, rendant plus naturel le geste polyphonique (c'était écrit pour les premiers virtuoses de la chose, entre violon basse et violoncello), la soliste opte pour celui de ses deux instruments baroques qu'enrichit dans les aigus une cinquième corde (de mi). On la sent alors se libérer, s'épanouir dans une ductilité, une conduite aérienne de la ligne, frôlant cette exécution plus raclante, plus ''à bras le corps'', possible sur un violoncelle moderne (on pense au grand initiateur Pablo Casals). Apport de la ''scordatura'', en somme (car on aurait plutôt attendu pour nouvelle corde un ré), comme c'est le cas pour la cinquième suite où - même question de facilité - la corde de la est abaissée d'un ton (réaccordée en sol). Merveilles en tout cas que tous ces solos ''sans basse continue'', dont aucun manuscrit ne nous est resté (seulement des corrections de la main de Bach), et non datés (on suppose la période de Köthen). Pour jouer ce genre de compositions, tout est dit dans un traité de 1752 : exprimer le clair et l'obscur, donner de l'énergie à toute la pièce, en maintenir la justesse de mouvement et le degré de vivacité, exprimer tant qu'il faut le piano et le forte, et d'autant plus faire distinguer les différentes passions qui s'y trouvent que bien les caractériser facilite beaucoup l'exécution de la partie concertante. Dont demi-acte à Viola de Hoog, élève d'Anner Bijlsma (qui enregistra deux fois ce corpus), mais aussi membre éclectique... du quatuor Schönberg ! (Gilles-Daniel Percet)
 |