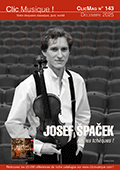Gustav Mahler avait révulsé une partie de la critique viennoise en osant étendre au quatuor des Wiener Philharmoniker l’opus 95 de Beethoven. Pourtant c’était pur acte de fidélité, la transcription était absolument respectueuse et réalisait à plein le discours beethovénien, dans ce cas Mahler ne rhabillait rien comme il le fit sans vergogne pour les Symphonies de Schumann, il divulguait et c’est ce que compris Felix Weingartner présent à la création de cette proposition. Il jeta son dévolu sur la Grande Fugue de l’op. 133, produisant une transcription qui fit illico oublier le travail de Mahler sur l’opus 95, Weingartner la dirigeant jusque dans les années vingt, et d’autres chef lui emboitant le pas jusqu’à Leonard Bernstein…. Lorsque Mahler décida de procéder ainsi pour La Jeune-fille et la mort de Schubert, il se trouva face à un dilemme tout autre. L’œuvre le passionnait depuis qu’il l’avait découverte, elle était devenue consubstantielle non seulement à son univers artistique, mais à sa psyché. Il lui fallait écrire sa jeune fille et la mort, glisser entre les portées de Schubert ses propres émotions. Le résultat est troublant, tant Mahler y parait dans la langue de l’auteur du Quartettsatz, ce que Gerd Albrecht fait entendre avec infiniment de subtilités lors de ce concert donné en 1993, au point que sa lecture cursive fait jeu égal avec l’enregistrement de studio de Jeffrey Tate jusque dans une mise en place au cordeau. La Grande Fugue est tout aussi étonnante, tant Gerd Albrecht, féru des nouvelles musiques qui voyaient le jour dans la première moitié du XXe Siècle, lui donne un ton expressionniste. Weingartner aurait-il reconnu dans ce geste si éloquent sa transcription qu’il espérait limpide ? (Jean-Charles Hoffelé)  A toute chose arrangée d'un Schubert, Mahler ne pouvait qu'être bon, et même plus puisqu'affinité. Au point qu'il avait également travaillé à l'orchestration d'autres quatuors du même, il en reste des preuves, voire des épreuves. Et il est curieux de constater (ouf, la première fois, on craignait un peu, au moins autant que ces contemporains viennois conservateurs qui prirent Gustav pour un Charlot : on a touché à la sainte musique de chambre !) à quel point ce fameux thème schubertien (pour ainsi dire, le chant d'un enfant mort...) migre sans dommage du simple chant à l'orchestre, en passant par le quatuor à cordes : face à son lugubre destin, toujours la jeune fille, mais naturellement dans tous ses états ! La finesse et la légèreté ici de l'orchestre et de son chef ne sont pas pour rien dans cette impression que l'essentiel est maintenu. Même si l'on peut trouver que cette instrumentation suramplifiée arrondit les angles du tragique, adoucit l'âpre et rugueux frottis des cordes, le mordant véhément des attaques. Par exemple, dans cet andante qui pour ses moments les moins révoltés n'est pas sans évoquer le typique adagio malhérien. Ce qui gêne finalement, c'est surtout cet épaississement côté contrebasses (instrument que la mode récente a pareillement bien tort d'ajouter aux arrangements originellement avec seul quatuor classique à cordes des concertos pour piano de Mozart). En complément de ce disque, l'orchestration d'une Grande Fugue qui n'a pas la rage : on imagine d'un Beethoven la véhémence échevelée qui se serait fait mettre le grappin dessus par madame Gomina. (Gilles-Daniel Percet)
 |