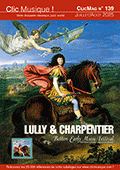On oublie souvent que Rossini, après « Guillaume Tell», arrêta de composer le moindre opéra à l’âge de trente-sept ans. Revenu s’installer à Paris où il passa ses dix dernières années, il se remit à écrire une musique de chambre et de salon destinée à un cercle de connaissances. Le présent enregistrement est consacré à certaines des œuvres pour voix et piano de cette ultime période. Tout Rossini y est concentré : virtuosité, mélodies entraînantes, expressivité. Il faut des artistes de très bon niveau pour se jouer des pièges et difficultés ! On savourera au premier plan le jeu du pianiste Marco Sollini plein d’allant et de nuances à l’écoute de ceux qu’il accompagne. Côté voix, ce sont la soprano Valentina Varriale, très à son aise avec les pirouettes imposées par le Maître, et le ténor puissant et clair de Giulio Pelligra qui sortent du lot. On sera plus réservé sur la mezzo Monica Carletti que l’on sent parfois légèrement à la peine. Le disque a globalement le mérite de révéler dans une solide interprétation générale un répertoire largement délaissé. (Thierry Jacques Collet)  La date fatidique de 1829, année de création du Guillaume Tell à Paris, et point d’orgue de la production d’opéras du maître de Pesaro, a longtemps été considérée comme la fin de sa carrière, suivie d’une longue retraite silencieuse (près de 40 ans !). Or il n’en est rien, Rossini, s’il a renoncé à la scène, continue à composer dans tous les genres de musique de chambre, essentiellement pour la voix, mais produisant également une grande quantité de pièces pour piano (même s’il se qualifie lui-même de pianiste de quatrième ordre), ainsi que quelques œuvres instrumentales. Il joue au patriarche lors de soirées musicales qui vont donner leur nom à un recueil publié à Paris en 1835, composé de 8 ariettes et 4 duos et interprété ici dans son intégralité par les interprètes très impliqués de ce disque. Le ténor Rubini, les basses Tamburini et Lablache, chanteurs du Théâtre Italien, font les beaux soirs de son salon devenu le lieu où il faut être vu. Parti pour l’Italie en 1836 pour un séjour qui sera marqué par la maladie et la dépression, il revient jeter ses derniers feux au cours de ses dix dernières années, au bord de la Seine, composant en 1859 les 3 canzonettas pour soprano en dialecte vénitien réunies sous le titre de Regata Veneziana, où Rossini met en scène avec son humour proverbial la coquette Anzoletta et son soupirant le gondolier Momolo. (Jean-Michel Babin-Goasdoué)  A cd in the spirit of fi nesse, both in the choice of the repertory, which includes 2 previously unpublished versions of Mi lagnerò tacendo (originals by the same Rossini) both in the choice of the interpretes. There are namesalready known in discography which alternate with young performers, which already debuted in important mise en scène and are winners of important prizes.
|