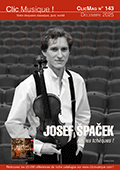Cette interprétation a été confirmée par de nombreuses analyses scientifiques mais elle n’est pas prouvée définitivement. Il est cependant certain que le Saint Suaire avec les caractéristiques de son empreinte, nous permet de mieux comprendre et de mieux méditer la passion de Jésus. Aussi le pape l’a-t-il défini comme «le miroir de l’Evangile». Les premiers témoignages écrits datent de la moitié du XIVème siècle quand Geoffroy de Charny, chevalier et homme de foi, déposa le Linceul dans l’église qui se trouvait dans son fief de Lirey, près de Troyes. Pendant la première moitié du XVème siècle, à cause de la Guerre de Cent Ans, Marguerite de Charny enleva le Linceul de l’église de Lirey en 1418, pour l’emmener avec elle lors de ses pérégrinations européennes. La dame trouva accueil à la cour des ducs de Savoie, liés à son père et à son mari, Humbert de la Roche. C’est ainsi qu’en 1453, le Suaire fut attribué à la Maison de Savoie à la suite de tout une série d’actes juridiques entre le duc Ludovic et Marguerite. A partir de 1471, Amédée IX, le Bienheureux, le fils de Ludovic, commença les travaux d’embellissement et d’agrandissement de la chapelle du château de Chambéry, la capitale du duché, en vue d’y abriter le Saint Suaire. Après une première installation dans l’église du couvent des Franciscains de Chambéry, le Linceul fut par la suite placé dans la Sainte Chapelle du Saint Suaire. C’est ainsi que la Maison de Savoie demanda et elle obtint du pape Jules II en 1506, la reconnaissance d’une fête liturgique en l’honneur du Linceul, fixée le 4 juin. Le 4 décembre 1532, un incendie ravagea la Sainte Chapelle et il causa d’importants dommages au Linceul qui furent réparés en 1534 par les sœurs Clarisses du couvent de Chambéry. En 1578, Emmanuel-Philibert transféra de manière définitive le Linceul à Turin. Il parvint dans la ville le 14 septembre, lors d’une grande cérémonie solennelle, au son des salves de canons. Depuis ce temps, le Saint Suaire est resté à Turin et durant les siècles suivants, il fut l’objet de nombreuses ostensions publiques ou privées. La présence du Linceul a fortement marqué la religiosité piémontaise comme en témoignent les nombreuses peintures que l’on rencontre dans la capitale et dans les villes et villages du duché. Les grandes et solennelles ostensions, très fréquentes pendant les deux siècles de l’époque baroque, soulignent l’importance de cette dévotion populaire.
 |