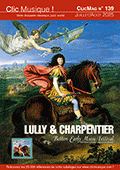Américain, Ned Rorem ? New-Yorkais, ce qui aux States veut dire quasi européen. Sa biographie plaide dans ce sens, à commencer par son Journal parisien. Ce que Ned Rorem sut de son métier, il l’apprit chez nous. Ces merveilleux songs, épars ou en cycle, écrits pour une voix haute un peu funambule, l’instrument exact de Laura Aikin, une Lulu, font une synthèse solaire entre le raffinement des mélodies françaises -il est souvent par l’esprit proche de Reynaldo Hahn – et une fantaisie transatlantique typique de cette génération : un peu de piment dans le classique : écoutez le "Song to a Fair Young Lady", délicieuse fantaisie avec un background élisabéthain. On n’est pas loin de "Candide". La clarinette ou le violoncelle viendront se joindre au piano, s’enlaçant à la voix où la chalengeant, la première dans le sublime Ariel sur les poèmes de Sylvia Plath : son cycle le plus osé, le plus astringent, un autre visage de ce génie discret dont les écrits, brillants et émouvant, ne doivent pas faire oublier les partitions. (Discophilia - Artalinna.com) (Jean-Charles Hoffelé)  « Je conçois toute musique en terme de musique vocale. Quelles que soient les forces pour lesquelles je compose - tuba, tambourin, carillon - au fond de moi c’est toujours le chanteur qui essaye de s’exprimer. » La musique de Ned Rorem, qu’on a parfois surnommé le Schubert américain, se caractérise par l’influence française, dont il s’imprègne au cours de ses longs séjours parisiens des années 1950, se liant d’amitié avec Poulenc, Milhaud, Auric ou Cocteau. Mélodiste affirmé, il compose plus de vingt-cinq cycles, parmi lesquels ceux présentés sur ce disque Orfeo, dont Last Poems Of Wallace Stevens (pour violoncelle) ou Ariel (pour clarinette), typiques de son style franco-américain, fondé sur les principes traditionnels de la métrique, de la structure mélodique et de l’harmonie. Schubert, quand il écrit un lieder, transforme le texte en un poème musical autonome ; Rorem, lui, va un pas plus loin : sa chanson est une réincarnation du poème, d’abord détruit pour renaître ensuite en musique. Ode et Jack L’Eventreur, deux pièces de 1953, répondent, elles, à une esthétique néoclassique, plus marquée par l’ouverture et la familiarité américaine que par la distance émotionnelle française. (Bernard Vincken)
 |