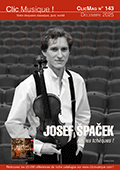Tradition ? Si ce n’étaient des vidéos qui polluent l’image filmée – en scène elles devaient prendre tout leur sens – on croirait bien que oui. Costumes quasi d’époque sinon quelques détails qui viennent y piquer une pointe d’exogène, comme le col de fourrure du manteau du burlador, décor ad hoc, ce Don Giovanni se regarde, croit-on, sans surprise. Hors Kasper Holten, désormais patron à Covent Garden, en réserve au moins une de taille. Ce n’est plus Don Giovanni qui fait la chasse aux femmes, mais les femmes qui l’assaillent et défaillent dans ses bras. A peine un séducteur, presque une victime. Ce retournement de caractère se glisse dans une lecture autrement de pure tradition et musicalement presque de routine : la faute à Nicola Luisotti et à ses tempos assis, à son orchestre épais. Littéralement on ne dirige plus Don Giovanni comme cela depuis quelques lustres. L’ensemble s’entend et se voit malgré tout sans déplaisir, d’abord pour le Don Giovanni si surprenant de Marius Kwicien, ligne parfaite, mots souvent à double sens. Leporello, le brillantissime Alex Esposito, est presque plus cruel que son maître, mais sur le point de l’autorité ne résiste pas vraiment face au Masetto stentor de David Kimberg, baryton décidément à suivre. Très remarquable Don Ottavio selon Antonio Poli, timbre et galbe, caractère et poésie, tout y est. Les femmes sont hélas dépareillées. Malin Byström campe une Donna Anna de grande venue et en grande voix, impressionnante de bout en bout, alors que Véronique Gens, le style et l’élégance même, semble bien pâle à ses cotés. Une Zerline mure nous change trop le personnage. Ensemble pas immortel, mais une soirée sans déconvenue (Discophilia, Artalinna.com). (Jean-Charles Hoffelé)  Pour une fois, le chef ne sera pas le maître d’œuvre. C’est la mise en scène, qui donne son unité et son sens à cette production. La grammaire de la scénographie contemporaine (décor unique et mobile, usage de la vidéo) est utilisée avec finesse (Finch’han dal vino entre autres exemples). Dans cet univers nocturne, voire cauchemardesque (final du I), la sensualité est étrangement absente (ironie du duo avec Zerline). Kwiecien compose un personnage blasé, spectateur de ses propres aventures, et qui ne retrouve vie que dans son affrontement final avec le Commandeur. L’encre remplace le sang, le catalogue est omniprésent, un Don Juan métaphysique donc, mais avec la prestance du rôle, et un velours de pur Kavalierbaryton (le phrasé de la sérénade !). Dans la froideur de cette vision, assumée par une distribution cohérente, une lumière : le chant très cœur sur la main de Véronique Gens, Elvire jusqu’au bout amoureuse et intercessrice. Depuis le continuo, Luisotti épouse chaque intention psychologique du metteur en scène, et respire idéalement avec les chanteurs, tout en mettant en valeur mille détails d’orchestration. Ne ratez pas ce Don Giovanni, certes peu aimable, mais profond et accompli, dramatiquement l’un des plus forts que l’on ait pu voir ces dernières années. (Olivier Gutierrez)
 |