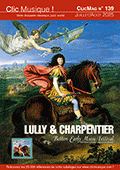L’anniversaire du tricentenaire de la naissance de Carl Philipp continue ! Frieder Bernius vient de se pencher sur le plus visionnaire des oratorios que nous ait laissé Carl Philipp Emanuel Bach : donné le 1er novembre 1769 pour la consécration de la Lazarett-Kirche sise hors des murs de Hambourg, Die Israeliten in der Wüste, sur un poème de Daniel Schiebler n’est pas inconnu au disque : je vis depuis longtemps avec l’enregistrement de William Christie : ton français, mise en lumière d’une écriture galante, tout ici rayonnait dans une lumière qui semblait passer par delà les souffrances du peuple d’Israël et les exhortations de Moïse. Cette fois, avec Frieder Bernius, la source jaillit du rocher, la parabole s’incarne, les mots germent comme un champ de blé. C’est le moins qu’on puisse entendre dans une partition si diseuse, et justement les solistes s’y emploient, Jonathan Lunn égalant Barbara Schlick dans la vocalise, Samuel Boden distillant les lignes si lyriques d’Aaron et Tobias Berndt donnant une stature entre révolte et affliction à un Moise qui sort du cadre. Bien vu (Discophilia, Artalinna.com). (Jean-Charles Hoffelé)  Hambourg fut pour Carl Philipp Emanuel Bach ce que Leipzig avait été pour son père : un dernier et durable port d'attache dont l'organisation politique, sociale et religieuse différait fortement de celle d'une cour aux besoins plus restrictifs. Tandis que le calvinisme régnant à Cöthen ne pouvait laisser entrer la musique à l'église, le déisme puis l'athéisme de Frédéric II orientèrent ses musiciens vers une inspiration essentiellement profane. Ainsi, les deux seules œuvres sacrées d'envergure que Carl Philipp Emanuel composa durant cette période ne furent pas destinées à Berlin. La création de son Magnificat se fit à Leipzig peu de temps avant la disparition de son père auquel il tenta, en vain, de succéder. Répondant à une demande plus diversifiée, leurs nouvelles fonctions dans un cadre moins centralisé renouvelèrent chez les deux compositeurs l'investissement des forces créatrices dans la musique sacrée. Chez C.P.E. Bach, outre maints psaumes et cantates « de circonstance », ce ne furent pas moins de vingt passions (perdues) et trois oratorios. Composé et créé en 1769, un an après l'installation à Hambourg, le premier d'entre eux, « Les Israélites dans le désert », illustre les nouvelles tendances développées par l'Empfindsamkeit, courant de la sensibilité. La dimension épique, théâtrale, que le même sujet inspira à Haendel trente ans avant (« Israël en Egypte ») et la primauté de la question théologique laissent place à la seule peinture des sentiments, des souffrances, de l'espoir du peuple en exil. L’immédiateté du rendu vise à émouvoir et non plus à édifier. L'intimisme, caractéristique du piétisme ayant attiré certains membres de la famille Bach, favorisant cette plongée dans le cœur de l'être que Carl Philipp Emanuel avait auparavant expérimentée, approfondie dans ses quelques deux cents lieder sur des textes sacrés, semble vouloir contenir les élans d'extériorisation des passions. L'esthétique et l'esprit de l'œuvre se définissent dans cette lutte interne qu’un chœur semble de temps à autres miraculeusement suspendre sinon résoudre. Les airs et récitatifs de caractère élégiaque, plaintif ou tourmenté, toujours profondément expressifs, trouvent une résonance précise et pleine. Les solistes de cet enregistrement y teintent comme naturellement leurs timbres des étranges couleurs harmoniques habituelles du maître et se fondent à merveille dans ces phrasés torturés par les modulations, les accentuations narratives et les ornements - entités irréductibles à ajouter au compte de C.P.E. - qui compliquent la conduite rythmique. Vingt ans après son Magnificat, « Les Israélites dans le désert » ressuscita, confirma et imposa le génie de C.P.E. Bach dans l'histoire de la musique sacrée. (Pascal Edeline)
 |