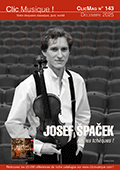Qu'importe l'interprète dans ton classique, ils jouent forcément pareil les mêmes notes ! Le décisif sort parfois à contrario d'un post-moderne surgavé binaire qu'aliène l'industriel boumboum compressé aimepétroisé strimingué, qui désormais gouverne (on a pris le maquis). Affaire de tact, de muscle, de neurone, de rendu, de pulsation, de modelé, de projection, d'équilibre du son (rare, avec ce trop puissant piano...), d'homogénéité des timbres qui frottent, glissent ou caressent, surtout de simple intelligence musicale, sans oublier ce matin la couleur du ciel par-dessus les toits si bleus si calme, ils ne sauront jamais combien référentiellement terminent nos chers jeunes suisses, bien loin des autres, le cycle du triolisme de chambre beethovénien. Cela commence divinement avec ces faussement négligeables (mon il, Beethoven tiendra à les reprendre plus tard !) variations sur « Ich bin der Schneider (je suis le tailleur) Kakadu », air d'opéra d'un certain Wenzel, dont l'introduction si belle dans un sombre si mineur ne s'empare même pas encore du thème des dix variations qui suivent (elles ont parfois un petit côté déploration mozartienne, ou bien titillent une idée de valse à la Diabelli). Moins personnel est encore, en premiers pas du jeune Ludwig pour cette formation de chambre, issu du septuor op. 20 et sans mouvement lent, le trio Wo0 38, de publication posthume, malgré la grâce enjouée de son scherzo qui est un miracle éthéré de microbattements d'ailes de phalènes. Entente parfaite enfin pour le triple concerto, dialogue attentif et parfaite fusion avec un orchestre lui aussi de chambre, tendance conduite non accompagnée (sans l'extériorité d'un chef), mais pareillement si juste et précis. (Gilles-Daniel Percet)
 |